La panique liée au Covid-19 replace la sécurité à la base des priorités humaines.
Pourquoi ?
La pyramide des besoins de Maslow apporte une réponse, et prouve sa pertinence.
En 1943, la très sérieuse revue américaine Psychological Review a publié un article proposant une théorie dont l’auteur, Abraham Maslow, allait devenir mondialement célèbre grâce à une pyramide.
 Aujourd’hui, l’emblématique pyramide de Maslow – ou pyramide des besoins – est tellement connue que lorsque l’on s’amuse à taper «pyramide» dans le moteur de recherche Google, elle arrive dans le trio de tête des suggestions, bien avant Gizeh !
Aujourd’hui, l’emblématique pyramide de Maslow – ou pyramide des besoins – est tellement connue que lorsque l’on s’amuse à taper «pyramide» dans le moteur de recherche Google, elle arrive dans le trio de tête des suggestions, bien avant Gizeh !
Cependant, la notoriété de l’outil ne vient pas tant de sa propension à expliquer les comportements humains, notamment de consommation, que des critiques qu’il a reçues depuis sa création. Maslow a pourtant élaboré son modèle jusqu’à sa mort, en 1970.
Lorsqu’Abraham Maslow, psychologue américain considéré comme le père de l’approche humaniste aux côtés de Carl Rogers, James Bugental ou encore Rollo May, propose son modèle, il part du principe que les besoins humains s’organisent en cinq catégories.
Là où le bât blesse, c’est lorsque l’auteur soutient que l’être humain ne s’engage à combler un type de besoin que lorsque le précédent a été satisfait.
Théoriquement, personne ne devrait donc créer de relation amoureuse sans avoir d’abord trouvé de quoi se nourrir physiquement, ni appartenir à un groupe social sans s’être d’abord assuré d’être en sécurité. Sauf que dans la réalité, ce séquençage ne fonctionne pas.
Au début des années 1980, le modèle «Foote, Cone et Belding» (FCB) est notamment venu bousculer la théorie de Maslow.
Cette matrice distingue les comportements d’achat intellectuels (réfléchis) des comportements d’achat émotionnels (impulsion), le tout selon un degré d’implication du consommateur lié à son budget, à la durée de vie du produit, à la valeur accordée à l’achat, etc.
Les auteurs soulignent que si le modèle de Maslow était vérifié, nous n’achèterions presque jamais de produits de luxe et les achats d’impulsion seraient inexistants tant que nous n’aurions pas déjeuné, ce qui n’est pas le cas.
Les consommateurs ou consommatrices sautent facilement un repas pour faire les soldes, appeler une personne chère ou acheter un produit non vital mais que le corps réclame en urgence, comme un paquet de cigarettes.
De même, on peut rechercher l’amour pour se sentir en sécurité dans des standards sociaux (niveau 3 puis 2) ou avoir l’ambition de l’accomplissement de soi avant de trouver l’amour, une maison, voire de quoi se nourrir correctement en travaillant des heures d’affilée sans sommeil ni apport calorique raisonnable (le niveau 5 passe alors avant tous les autres).
Malgré la pertinence des besoins qu’elle identifie, le séquençage de la pyramide de Maslow ne fonctionne donc pas.
Sauf que cette conclusion s’insère dans un contexte politiquement et psychologiquement stable.
Dans le contexte instable de ce début d’année 2020, le Covid-19 apparaît comme un point d’inflexion remarquable, qui rebat les cartes de la hiérarchie des besoins.
Remarquable car il concerne la totalité de la population mondiale, sans distinction de niveau social, de goûts de consommation, d’âge ou de genre, mais surtout car il réhabilite la pyramide de Maslow en replaçant la sécurité à la base de la hiérarchie des besoins, au niveau 2, après les besoins physiologiques.
Les besoins d’appartenance, d’estime ou d’accomplissement (niveaux 3, 4 et 5) repassent après, comme l’illustrent les conséquences observables de la propagation du coronavirus.
En Chine, le confinement et la crainte de la contamination ont considérablement réduit toute activité, comme l’illustre notamment la chute drastique du niveau de pollution dans la zone géographique autour de Wuhan.
De même, les acteurs sont contraints de repenser leur activité : les circuits longs se raccourcissent, les marques de luxe, rassurantes en matière de valeur, perdent peu à la Bourse et des marques telles que Veolia (traitement de l’eau), Carrefour (il faut se nourrir) ou encore Engie (l’énergie est un besoin fondamental) tirent leur épingle du jeu.
Ce basculement s’observe également à l’échelle comportementale.
On ne se saluera désormais plus au travers d’une bise ou d’une poignée de main, ce qui risque de s’ancrer dans les coutumes occidentales si le danger sanitaire devait persister.
Désormais, rien d’autre ne compte que de survivre :
- les denrées alimentaires sont redevenues la priorité (niveau 1 de la pyramide) afin de pouvoir rester en confinement chez soi, en sécurité (niveau 2) et éviter la contamination.
Le besoin d’appartenance conforte sa place au niveau 3 : une fois que la survie et la sécurité sont assurées, on a besoin de prendre des nouvelles de ses proches, notamment s’ils sont en voyage, en zone critique ou, pire, en quarantaine.
Quant à la reconnaissance et à l’accomplissement de soi (niveaux 4 et 5), cela viendra en temps voulu.
Ainsi, de la même manière que l’augmentation du prix de l’or envoie un signal de défiance aux marchés financiers, le fait que le séquençage originel de la pyramide de Maslow fonctionne indique que la planète va mal.
Sa réhabilitation devrait vraiment nous faire réfléchir à nos priorités, évidemment en période de crise ou de conflit, mais surtout lorsque le ciel est bleu…
–
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons.
Lisez l’article original.
-> Psychothérapie et/ou coaching : les séances se font à mon cabinet toulousain, ou en télé-séances par Skype, WhatsApp ou Zoom (cliquez sur les liens en haut de ce blog « duvallevesque-psychotherapie-hypnose.fr » pour plus d’informations utiles. Et mailez-moi pour tout conseil dont vous avez besoin)
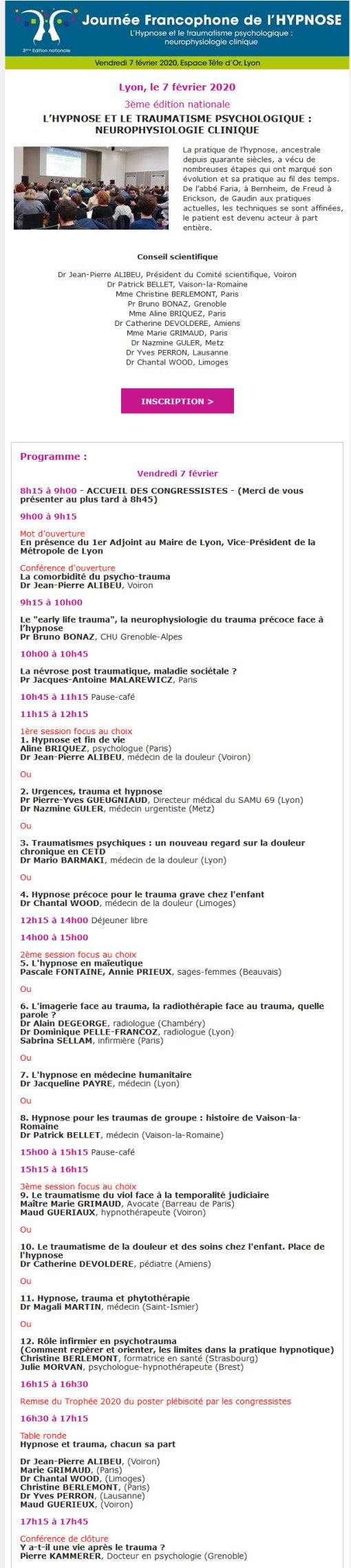
 Voilà pourquoi, sans négliger les progrès considérables de la biomédecine et des neurosciences, il est urgent de remettre le patient au cœur du phénomène douloureux.
Voilà pourquoi, sans négliger les progrès considérables de la biomédecine et des neurosciences, il est urgent de remettre le patient au cœur du phénomène douloureux.